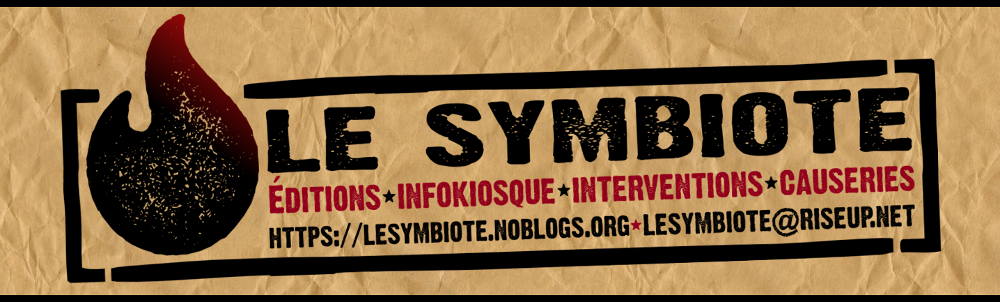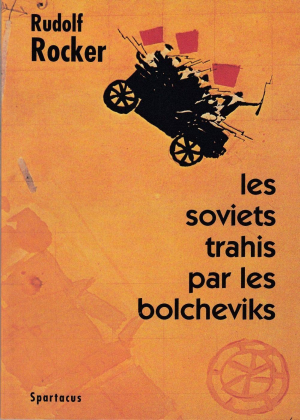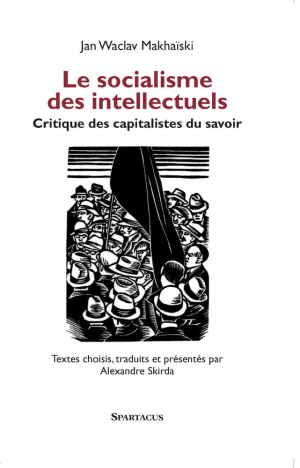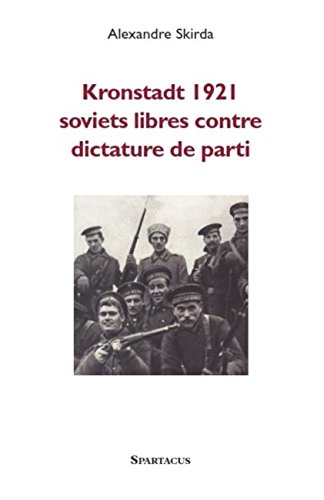Il s’agit là de la première critique d’ensemble du régime bolchevik d’un point de vue anarchiste, parue en Allemagne en 1921 sous le titre La faillite du communisme d’État russe.
Rudolf Rocker, militant anarcho-syndicaliste, avait au cours d’une longue période d’exil à Londres participé aux combats des ouvriers de la confection contre l’exploitation ; rentré en Allemagne en 1918, il avait œuvré au regroupement des militants anarcho-syndicalistes.
Dans ce livre, il montre comment, devenus maîtres des Soviets qui étaient nés de l’action spontanée des masses, les bolcheviks, après s’être emparés des pouvoirs étatiques, en ont usé pour tenter d’intégrer à l’appareil d’État toutes les autres tendances révolutionnaires, ainsi que pour diffamer, calomnier, éliminer et massacrer quiconque refusait de se soumettre. S’appuyant sur des témoignages de première main, il dénonce les méthodes des bolcheviks qui ont, par exemple, cyniquement trahi le pacte conclu avec les troupes de Makhno, aggravé la famine qui sévissait déjà en détruisant les communes et les coopératives paysannes pour bâtir un État tout-puissant, prétendument socialiste, instrument d’une nouvelle forme de l’esclavage salarié.
Cliquer sur la couverture pour accéder au pdf du livre :
Sommaire : Rudolf Rocker, par Jean Barrué – Chapitre I : la faillite du communisme d’État russe – Chapitre II : Un faux argument historique – Chapitre III : L’activité « contre-révolutionnaire » des anarchistes russes – Chapitre IV : Nestor Makno et les bolcheviks – Chapitre V : L’insurrection de Cronstadt – Chapitre VI : Origine et signification de l’idée de conseils – Chapitre VII : L’idée de dictature, héritage de la bourgeoisie – Chapitre VIII : De la nature de l’État – Chapitre IX : De l’essence de la révolution populaire : liberté et socialisme – Chapitre X : La IIIe Internationale, organe de la politique d’État bolchevique – Chapitre XI : L’influence du bolchevisme sur le mouvement ouvrier international – Chapitre XII : La malédiction du centralisme.
Le livre est édité par les éditions Spartacus.
« Une vraie libération n’est possible que lorsque l’appareil du pouvoir disparaît, car le monopole du pouvoir n’est pas moins dangereux que celui de la propriété. C’est seulement ainsi qu’il sera possible d’éveiller toutes les énergies qui sommeillent dans le peuple pour les faire servir la révolution. C’est ainsi, aussi, que disparaîtra la possibilité pour un parti — et pour la simple raison qu’il est parvenu à s’emparer du pouvoir — d’opprimer toutes les tendances véritablement révolutionnaires, parce qu’il le faut prétendument « dans l’intérêt de la révolution », bien que l’on sache que, dans ce cas, l’« intérêt de la révolution », ne signifie jamais que celui du parti ou d’une poignée de politiciens avides de pouvoir et sans scrupules. »