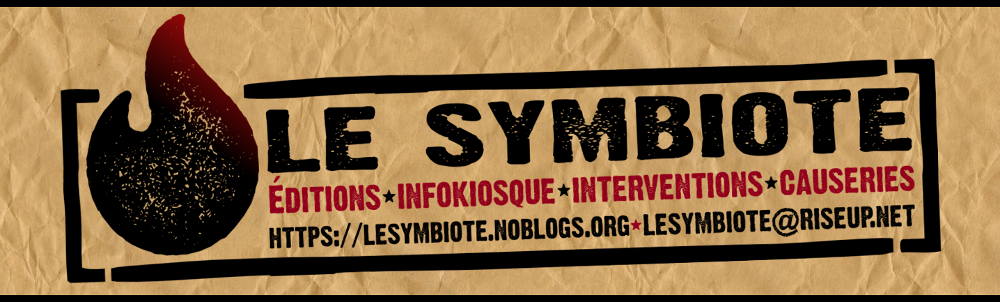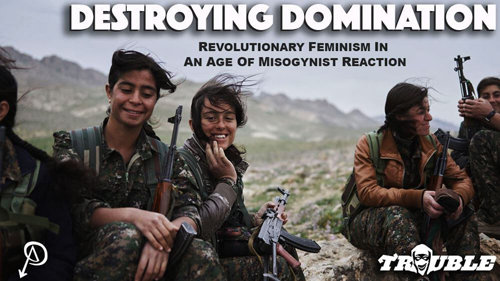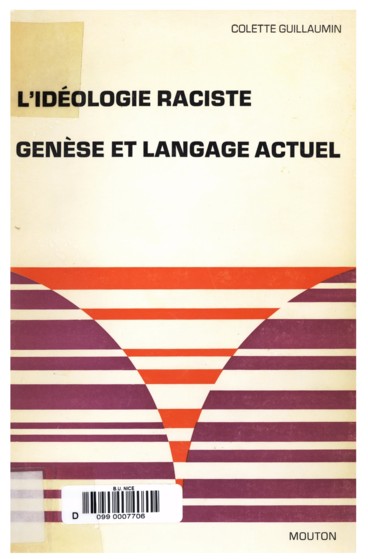Une émission de Sortir du capitalisme sur les racines communes du capitalisme, des classes, du néo-patriarcat et du néocolonialisme raciste, pour une théorie critique émancipatrice de toutes les dominations sociales – avec Benoît Bohy-Bunel (théoricien critique, professeur de philosophie).

Une émission avec la division capitaliste du travail comme angle d’attaque d’une théorie critique visant à l’abolition émancipatrice des classes, du néo-patriarcat et du néocolonialisme. Avec une introduction autour de la théorisation chez Marx et chez Lukacs de la division capitaliste du travail, suivie d’une première partie autour de la prolétarisation liée à la rationalisation tayloriste du travail et autour de la division capitaliste de classes. Et avec une deuxième partie autour d’une explication matérialiste du patriarcat et du dualisme de genre, d’une part, et du racisme systémique, d’autre part, avant une conclusion autour de l’idée qu’il faut une convergence des luttes autour d’un projet d’abolition de toutes les formes de dominations sociales (impersonnelle, de classe, patriarcale, raciste).
Écouter l’émission :
ou la télécharger ici (clic-droit > enregistrer sous)